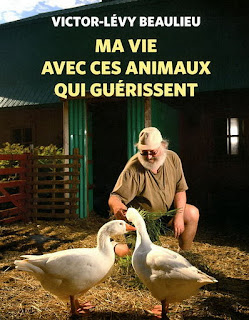|
Proust, la cuisine retrouveé, 1991 Anne Borrel |
Ce matin, au réveil, je tombe sur ces mots griffonnés la veille au dos d’une facture d’épicerie : « La soupe à l’os du samedi de ma mère est un problème insoluble. » Je sais bien que cette phrase est impossible, maladroite, syntaxiquement et sémantiquement incorrecte. J’ai beau la retourner dans tous les sens, rien n’y fait : je reviens toujours à la première formule. « La soupe du samedi à l’os de ma mère… » me paraît tout aussi équivoque que « la soupe à l’os de ma mère du samedi… ». On le voit clairement : le problème est une question d’os.
J’aurais pu me contenter d’écrire : « la soupe à l’os », « la soupe du samedi », « la soupe de ma mère… ». Pris isolément, chacun de ces éléments pourrait constituer le début d’une phrase autonome. Mais j’aurais l’impression de travestir la réalité, de trahir ma mère, car ce dont il est question, ici, ne relève pas de la gastronomie à proprement parler. C’est de LA SOUPE À L’OS DU SAMEDI DE MA MÈRE dont je veux parler, pas de la soupe en général!
C’était une soupe réconfortante, riche en vitamines et en minéraux, fumante, une soupe qui réchauffait à la fois et le corps et le cœur, une soupe d’hiver, constituée essentiellement d’un bouillon de bœuf maison, de poireaux, de feuilles de céleri, de carottes, de navets et de tomates. C’est la soupe que ma mère nous concoctait tous les samedis, de la fin octobre jusqu’au début mars.
Pendant des années, j’ai cru, à tort, que le secret de la soupe de ma mère, la soupe à l’os du samedi, résidait exclusivement dans la quantité et la qualité des os. Puis, un jour, j’ai compris que ce n’était ni la préparation ni le choix des ingrédients qui conféraient à cette soupe son goût si unique, mais bien plutôt tous les souvenirs qui s’y rattachaient.
C’est en lisant Proust, bien des années après, que j’ai compris que la soupe que ma mère préparait de manière si attentionnée le samedi, cette soupe à l’os, relevait davantage du phénomène de la mémoire involontaire que du goût de la soupe proprement dit, que cette soupe, pour être vraiment appréciée, ne pouvait être servie que le samedi, de préférence à midi, en plein cœur de l’hiver, à une tablée d’enfants aussi affamés que turbulents.
Ainsi, aujourd’hui, je puis écrire, en toute légitimité : « La soupe à l’os du samedi de ma mère est une phrase syntaxiquement française » : c’est Le Temps retrouvé, dans toute sa quintessence.